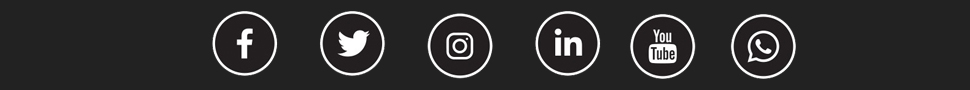Gabès cinéma Fen 2020 : un nouvel espace documentaire en réflexion
La deuxième édition du Gabès cinéma Fen s’est déroulée en ligne du 3 au 11 avril 2020. Réservées au public tunisien aux heures de projection prévues par le festival, les séances permettaient de voir les films à la maison et ensuite de participer aux débats avec les cinéastes. Avec une programmation exigeante sous la houlette du documentariste Sami Tlili, ce festival du Sud tunisien croit à l’intelligence du public et à son désir de découvertes, ce que confirme sa section art vidéo. Huit documentaires étaient présentés dans la compétition longs métrages sur les onze dont les droits avaient pu être négociés pour l’accès en ligne. Ils témoigne de la volonté du festival d’être en prise sur les réalités du monde.
Alors que le prix du meilleur long métrage est allé au magnifique Tlamess (Sortilège)d’Ala Eddine Slim, une radicale expérience de cinéma en liberté (cf. [critique n°14885]), une des trois mentions spéciales attribuées par le jury composé de Jilani Saadi (Tunisie), Suzy Gillet (Royaume Uni), Laura Klockner (Allemagne) et Rania Stephan (Liban) est allée à une autre merveille : Talking about Trees du Soudanais Suhaib Gasmelbari dont la réussite tient à sa construction ludique du réel permettant de toucher à l’essentiel, un dispositif documentaire qui affirme la force de l’art face à la barbarie (cf. [critique n°14826]).
Effectivement, « rien n’est filmé sans film », écrivait Jean-Louis Comolli. Un documentaire est un geste de création. Il implique des choix tant esthétiques que de montage, c’est-à-dire de tri en fonction d’un point de vue critique. Mais aussi et surtout, loin de l’illusion mimétique, une intention durant le tournage, même si l’œil est à l’écoute de ce qu’offre la réalité et de ses résistances.
Aucun des films présentés ne cherche à faire comme s’il n’y avait qu’à appuyer sur le bouton de la caméra. Tous ont une démarche, souvent une relation directe avec le sujet, et la volonté de rendre visible ce qui ne se donne pas en tant que tel.
Le Sentiment d’être surveillé (The feeling of being watched) d’Assia Boundaoui est à cet égard un cas d’école. Elle cite d’entrée Michel Foucault à propos des moyens de surveillance qui reprennent le principe du panoptique : « Le pouvoir disciplinaire s’exerce en se rendant invisible. Il impose à ceux qu’il soumet un principe de visibilité obligatoire. C’est le fait d’être vu sans cesse qui assure l’emprise du pouvoir qui s’exerce sur eux. » Constatant que la surveillance est continuelle, la journaliste Assia Boundaoui en vient à s’intéresser à une vaste enquête anti-terroriste du FBI nommée « Vulgar Betrayal » (« trahison de mauvais goût » !) menée avant le 11 septembre, sa famille ayant été concernée mais aussi tous leurs voisins dans le quartier arabo-américain de Chicago qu’ils habitent. Au fur et à mesure qu’elle avance, elle quitte la distance journalistique pour devenir toujours plus imopliquée, se rendant compte à quel point cette surveillance est une atteinte à son identité : pour échapper au soupçon et ne pas faire peur, « parler de moi implique de dire d’abord ce que je ne suis pas ». Cette suspicion de tout ce qui est musulman dans le pays enferme ces citoyens américains dans des stéréotypes dont ils ont du mal à se libérer : elle avoue être sensible à l’image qu’elle donne, cherchant à montrer qu’elle parle bien anglais et agit « normalement » !
Arrivant enfin grâce à une attaque en justice à obtenir ce qu’elle cherche, elle est confrontée à la même réponse que Robert Bilott dans Dark Waters de Todd Haynes (2019) : engloutie sous des milliers de documents quasi-impossibles à gérer. Mais elle ne lâche pas et encourage les gens du quartier à demander en justice la communication des enquêtes faites sur eux.
Lors d’une table-ronde sur le film dans le cadre des « Carthage talks » durant les Journées cinématographiques de Carthage 2019, le critique Ikbal Zelila notait le choix de la réalisatrice d’être en intimité avec les personnes par opposition aux caméras de surveillance qui cadrent de loin avant de se rapprocher – et donc de privilégier ainsi l’humanité des gens concernés. C’est donc bien un contre-regard, un regard de résistance, qu’Assia Boundaoui voulait construire pour, selon sa propre expression, « contribuer à réconcilier sa communauté avec sa propre image ». En accord avec Foucault et appliquant la maxime « je vous observe en train de m’observer », utilisant parfois les ficelles du film de contre-espionnage, elle rend visible la surveillance du FBI et analyse à travers sa propre réaction comment ce harcèlement rend paranoïaque. Cela ne vient pas en un jour : 200 heures de rush en cinq ans suivis d’une année de montage.
De ses propres mots, Assia Boundaoui visait « l’empathie plutôt que la solidarité ». Elle a diversifié son équipe pour qu’on la différencie des « Blancs d’âge moyen » du FBI. De même, elle a placé une femme à la caméra. Son point de vue a changé « en passant de l’analyse des faits à une tentative de les comprendre et d’en trouver la source ». Elle assume complètement d’avoir pour objectif de contrer les visées du FBI, de démontrer à sa communauté qu’il est possible de lui résister. Elle est souvent à l’écran, menant l’enquête, au centre de l’action, sans neutralité aucune, cherchant une complicité avec les habitants, en phase avec la rage de sa mère et soutenue par sa famille et l’équipe qui l’aide à démêler les documents. Le film scelle un front commun, auquel le spectateur est invité à adhérer.