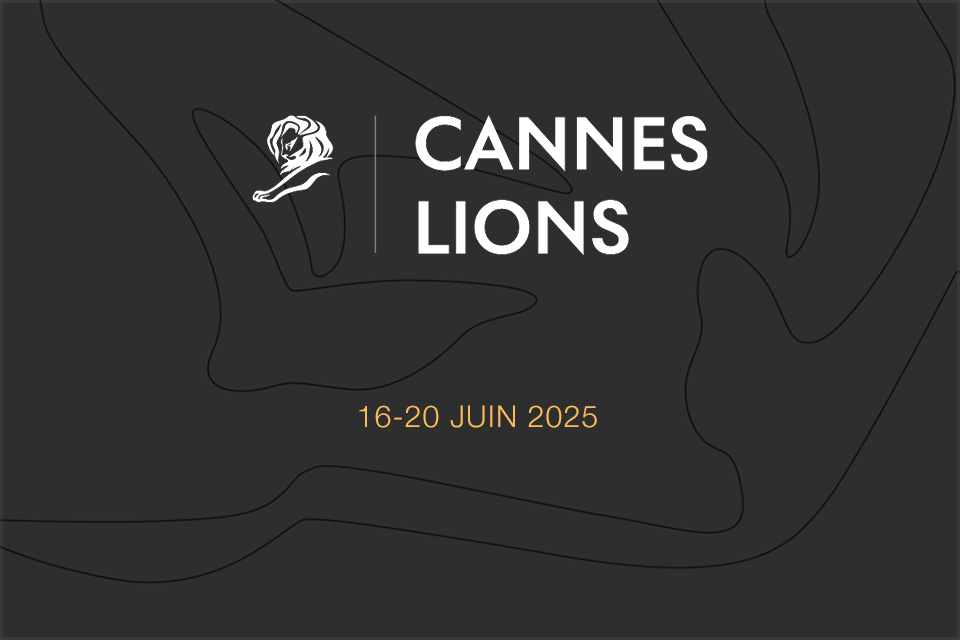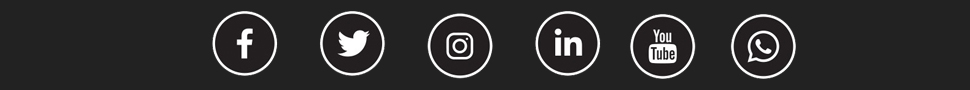(c)Droits réservés
(c)Droits réservés
Basile Nganguè Ebelle : « Quand on a des identités fortes, on n’a pas peur de l’autre
La 16ème édition du festival international du film panafricain de Cannes se tient du 17 au 21 avril 2019. Militant du panafricanisme, son promoteur revient sur l’essence de ce projet. Il revendique un modèle économique qui garantit une liberté d’expression sur la promotion des identités africaines. Entretien…
Le Festival international du film panafricain de Cannes se déroule dans quelques jours. Où en êtes-vous avec les préparatifs ?
Tout est finalisé. Tout est bouclé. Tout est prêt, on va le dire ainsi. Nous sommes à même d’offrir un très beau festival en 2019, avec de très beaux films. Cette année, nous venons avec une autre dynamique, une nouvelle création intitulée « Le Salon entreprendre Culture et bien-être », qui est le prolongement du salon panafricain qu’on avait et qui reflète aujourd’hui, toute sa profondeur. Ce qui renvoie à nos valeurs, car nous sommes une entreprise alternative qui est dans une démarche sociale et solidaire, un socle culturel comme éléments d’ouverture et un bel outil pour permettre aux gens de travailler pour l’élévation de l’être et pour l’élévation de soi.
Quelles vont être les autres particularités de cette 16ème édition du festival que vous promouvez ?
L’édition 2019 est particulière dans plusieurs sens. Nous lançons une nouvelle entreprise, mais il y a aussi le fait de conforter l’acquis, c’est-à-dire le business model qu’on a créé depuis 2004 qui est celui de l’indépendance totale. L’avantage du festival du film panafricain de Cannes est qu’il reste quand même l’une des seules entités au monde à être autonomes. Nous ne bénéficions d’aucune subvention publique. On est une entreprise totalement indépendante, à la fois auto-financée et soutenue par ses créateurs. Donc, c’est pour nous un challenge permanent qui nous permet d’en faire ce qu’on veut, c’est-à-dire, un outil qui ressemble un peu plus aux cinéastes panafricains d’aujourd’hui, qui fait ce qui lui plaît, qui a envie de construire quelque chose qui lui plaît, qui est créatif, qui n’attend pas de l’autre. Nous sommes une entreprise totalement indépendante qui a cette liberté de création. Et nous avons la particularité d’être sur une très belle place. On est à Cannes, une ville qui reste la capitale du cinéma mondial. Tous ces éléments conjugués font que nous avons un festival particulier. L’autre particularité, c’est la diversité des pays qui vont participer à ce festival. Nous avons la chance d’avoir cette absence de barrières dans le monde panafricain. Nous parlons à l’africain d’Afrique, l’africain canadien, etc. Vous pourrez y rencontrer des réalisateurs asiatiques ou américains, car à partir du moment où ils proposent des histoires mettant en scène un univers panafricain, des acteurs ou actrices panafricains.es dans un espace où l’on retrouve cette diversité, ils sont concernés par nos idéaux. Ce qui nous intéresse c’est de sortir de ces œuvres, celle qui sera à même de montrer l’évolution, l’impulsion, la créativité des œuvres panafricaines.
Vous défendez l’idée que le cinéma rassemble la mode, la beauté, la photographie, etc. Pensez-vous que cette idée est comprise par les publics, notamment ceux de votre festival ?
Pour certains d’entre eux oui. En même temps, c’est à nous d’être pédagogues. On est parti sur un constat simple. Je suis un homme de radio. J’ai beaucoup travaillé dans le secteur de la musique. Je savais, en vivant ces différentes expériences, que je passerais par le cinéma, parce que je suis né dans un pays [le Cameroun, Ndlr] où le cinéma était très présent. Le Cameroun des années 70 était dans cette énergie-là. Il y avait beaucoup de salles de cinéma, beaucoup de salles de spectacles, etc. La dynamique culturelle était exceptionnelle. La musique camerounaise des années 80 gouvernait le monde. Cette vision d’ensemble de la culture à travers le cinéma est, pour moi, quelque chose de réel, de vivant. Et puis, c’est dans l’ère du temps, avec, évidemment, l’avènement des nouvelles technologies. Il y a donc forcément une certaine ouverture. Finalement, tout est conjugué aujourd’hui. Les femmes perçoivent mieux cette imbrication. Elles comprennent mieux qu’un cinéma sans accessoires n’existe pas, qu’un cinéma sans musique, ni mode non plus. C’est vrai que certains auront beaucoup de mal à voir les choses sous cet angle, mais l’une des fonctions de l’être humain c’est aussi de savoir s’adapter, appréhender les choses.
Vous parlez beaucoup de diversité. Et, justement, le Festival international du film panafricain de Cannes a pour objectif de montrer la diversité à travers le cinéma. Quel regard porte-vous sur la question de l’identité aujourd’hui ?
L’identité est une question essentielle. Je parle de diversité aujourd’hui. Hier, certains prônaient déjà le métissage. Donc, c’est quelque chose qui a toujours été véhiculé. Mais, cela n’empêche pas la singularité de l’identité. Je suis le premier à le prôner. J’estime que je suis un produit de l’éducation douala, que je suis un produit de l’éducation camerounaise. Même si j’ai côtoyé l’éducation française et celle du monde à un moment donné, cela ne m’empêche pas profondément d’être un vrai bantou. Tout cela conjugue avec les identités plurielles. On a trop longtemps renié le socle qui, pour moi, est quelque chose d’essentiel, quelque chose qu’on a besoin de porter de nouveau à la lumière, parce que ça permet la rencontre avec l’autre. L’identité forte que j’ai, me permet de côtoyer l’autre, dans le respect de l’être. Avec le recul et peut-être aussi du fait d’avoir quitté le sol camerounais, je me rends compte de la richesse que j’ai d’être né douala, sawa et camerounais. Ça permet d’apprécier ce que je suis, et ce que je suis devenu. Quand on a des identités fortes, on n’a pas peur de l’autre. On n’a pas peur de la culture de l’autre, parce que la culture de l’autre nous enrichit. Donc, autant je revendique mon identité sawa, autant je me sens européen sans que cela ne pose problème. Il faut vraiment trouver le juste équilibre. Aujourd’hui, au Cameroun, on assiste à une crise. Les parties anglophones du pays revendiquent la singularité de leur identité. Il faut qu’elles s’expriment. La crise existe parce qu’il y a rejet. Or, si l’identité est forte, on n’en arrive pas là. Après tout cela, il faut savoir quoi en faire, développer une certaine éthique. De ce côté-là, je dis merci à mes ancêtres.
Vous pensez que le marché des arts africains va exploser dans les prochaines années. Quels sont les éléments qui vous font croire cela et avez-vous le sentiment que cette idée soit partagée sur le continent africain ?
L’Afrique est la terre de l’avenir. Elle a une créativité totalement inexploitée. Justement, ses identités et ses cultures fortes font qu’il y a énormément de choses à explorer. Maintenant, il faut se réapproprier son identité et sa culture pour donner de la valeur à ce qu’on fait aujourd’hui. En conséquence, l’Afrique est un grand marché. Dans cet ordre-là et surtout dans sa dynamique de réappropriation de sa culture, le marché ne peut qu’exploser. Le challenge c’est de réguler tout cela. Il y a quand même un cadre à définir. D’un autre côté, le regard vis-à-vis de l’Afrique change. Il n’y a pas très longtemps, je disais, pendant mes conférences, que j’ai la chance d’être né en Afrique. Je voyais les gens me regarder d’une drôle de manière avant de me traiter de fou. Je leur répondais que je ne suis pas né dans une Afrique malheureuse, bien au contraire. Donc oui, je le crois fermement, et ça se voit avec des exemples comme Nollywood qui, aujourd’hui, ne se contente plus du Nigeria. Les productions de Nollywood sont regardées partout dans le monde.
De nombreux projets culturels rencontrent des difficultés financières à un moment de leur existence. Comment vous faites pour résister depuis 2004 ?
Je suis de la culture Sawa. On nous a appris à bien gérer, à savoir bien faire avec peu. En fait, on a positionné un business model qui est simple. Au départ, on était les premiers à faire en sorte que ceux qui participent à nos activités apportent leurs contributions. Nous n’avons rien inventé, en réalité. On n’a fait que suivre ce que les anciens ont fait avant nous. C’est un projet d’économie sociale et solidaire. Donc, nous nous sommes appuyés sur des âmes de bonne volonté. Donc, il n’y a pas, dans ce projet, quelqu’un qui travaille pour lui-même. Toutes les personnes qui gravitent autour du festival sont des développeurs de projets qui apportent leur force et, à partir de là, on crée une chaîne. On est vraiment ensemble. L’idée selon laquelle les Africains ne sont pas solidaires n’est pas vraie. L’humain est naturellement solidaire et sociable. Nous on a utilisé ce credo alternatif. Aujourd’hui, on ne souhaite pas forcément des portes de financement. A la base nous sommes partis sur un business model éducatif, pour montrer à nos descendants qu’il est possible de faire sans. Lorsqu’on a une culture à positionner, à valoriser, on fonctionne différemment. La seule chose qu’on peut donner à l’Afrique, c’est d’entreprendre, mettre des choses en place pour valoriser le continent. Evidemment, ceux qui ont envie d’apporter leurs contributions sont les bienvenus. En outre, après le lancement de ce projet, une tournée nord-américaine m’a conduit de Boston à Vancouver, en passant par Los Angeles, etc. Je savais qu’il fallait aller à la rencontre de ceux qui sont déjà conscients de l’importance de valoriser librement cette identité que nous défendons. Ceux qui viennent le plus au Festival international du film panafricain de Cannes ce sont les africains-américains. Et leur présence se ressent aussi dans la programmation. Ils viennent sans se poser de questions parce qu’ils se sentent concernés et savent qu’ils doivent soutenir ce type d’initiatives. Ils n’attendent pas d’être invités ou de recevoir un billet d’avion.
En tant que panafricaniste, avez-vous le sentiment que la notion de panafricanisme apparaît dans les productions cinématographiques africaines ?
De plus en plus, on revient à cette notion d’identité. Mais, une fois de plus, l’identité n’est pas une barrière devant mener à l’intolérance. Je prends un exemple qui me vient à l’esprit. J’ai récemment regardé un excellent documentaire qui nous vient de la Guyane et qui est intitulé « Les pépites du fleuve ». Quand je regardais ce documentaire, je revoyais cette manière de revivre l’Afrique, à travers cette diaspora. J’ai vu comment l’essence culturelle, les traditions, les langues ont pu résister. Je voyais les coiffures des jeunes femmes, des jeunes filles, et j’étais heureux, parce qu’aujourd’hui, la femme africaine a tendance à nous dire que le fait de porter des perruques est quelque chose de naturel alors qu’en fait, pour nous qui avons vu comment on traite les cheveux, c’est un choc. Ce n’est pas du conservatisme à outrance. Mais, c’est juste le fait d’assumer son identité. Dans d’autres films également présents à ce festival, on voit ces éléments identitaires. L’Afrique a besoin de reconstruire un monde, d’impulser un vent nouveau.
Quel est votre rêve pour le cinéma africain ?
Qu’il soit meilleur, qu’il soit lui-même. Le cinéma africain a l’obligation d’être le meilleur cinéma au monde, d’être dans une dynamique de réussite, de recréer le monde. Pour moi, il n’y a pas d’autres questions à se poser. Le monde en a besoin. La création a donné les clés à l’Afrique. Tous ceux qui vivent dans ce monde aujourd’hui viennent d’Afrique. Les cinéastes africains n’ont pas le choix. Soit ils se voilent la face, soit ils sont eux-mêmes et recréent le monde.